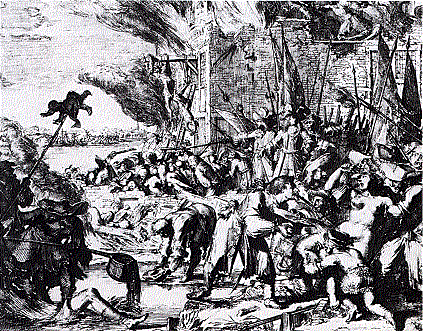
Exactions françaises vers 1672 selon un contemporain hollandais
(gravure de Roamin de Hooghe, BNF)
L'inconduite
des
gens de
guerre à l'égard des populations, en France comme
à l'étranger, est notoire sous Louis XIV.
Il
est vrai que les périodes
précédentes étaient tout aussi
terribles
: les guerres de religion virent nombre d'atrocités en
France, puis la Guerre de Trente Ans ravagea profondément
l'Allemagne. Le comportement des armées
françaises
de la seconde moitié du XVIIe siècle, par exemple
pendant la Guerre de Hollande 1672-1678, suit ainsi les
néfastes
usages de cette époque...
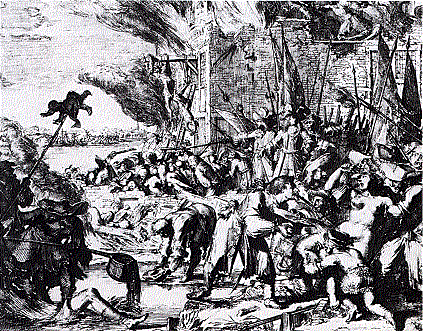
Ces
comportements frappent
les contemporains, qui ont du mal à admettre que les troupes
agissent de la même manière à
l'intérieur
du royaume ; mais les autorités s'en servent
parfois
volontairement,
que ce soit pour mater
les révoltes
ou contre les huguenots.
A
partir des années
1670 et 1680, la réorganisation de l'armée et
l'amélioration
des conditions de vie des soldats permettent une
amélioration
progressive de la discipline
: les exactions les plus
scandaleuses
semblent diminuer.
Néanmoins,
le
comportement
des troupes reste très difficilement
supportable pour les
populations qui les hébergent.
La
répression
de la « révolte
du papier timbré » est
révélatrice de
l'attitude des autorités et d'une partie de la noblesse.
De
graves troubles et
émeutes contre
les taxes sur le papier timbré, le tabac, et la vaisselle
d'étain, ont lieu dans différentes villes et dans
les campagnes, en avril, mai, juin, et juillet 1675.
Le
duc de Chaulnes,
gouverneur de Bretagne,
tente dans un premier temps, dans ses rapports à Colbert,
de minimiser l'ampleur des troubles pour diminuer sa propre
responsabilité.
Puis, il n'hésite pas à proposer des mesures
radicales :
Il n'est pas seul
à demander une
répression active :
Les
troupes
demandées arrivent finalement
en Bretagne, et entrent à Nantes en août. A leur
tête, le gouverneur fait le tour de la province en faisant
nombre d'exemples :
Finalement,
le
gouverneur et les troupes
entrent à Rennes le 12 octobre. Plusieurs personnes sont
arrêtées, certains sont
exécutés, le
Parlement de Bretagne est exilé à Vannes, les
rennais
sont lourdement taxés, et les habitants du faubourg de
la rue Haute sont chassés. Mais en même temps, les
troupes sont encore tenues en main, et un soldat est même
exécuté en public pour avoir molesté
ses
hôtes.
Cela
s'aggrave
début décembre
: les troupes d'élite arrivées en premier
quittent
la Bretagne, remplacées par des unités moins
disciplinées,
que le roi envoie passer l'hiver sur place.
Ce
qui semble beaucoup
choquer les contemporains,
y compris le gouverneur lui-même, c'est que ces troupes
se comportent alors comme elles le font normalement... à
l'étranger !


Les
abus et exactions sont
donc nombreux parmi toutes les troupes. Ce site étant en
partie consacré aux Compagnies de la Marine, voici quelques
mentions les concernant :
Un
cas précis, en
1692, à Lesneven (près de Brest) :
« Mardi
7
octobre :
Les compagnies franches de la marine, en quartier d'hiver à
Lesneven, ne vivent point en bonne discipline, faisant venir leurs
familles qui sont imposées aux habitants par les soldats,
lesquels exigent plus que la subsistance réglementaire.
Les habitants disent même n'avoir plus aucune assurance
de la vie. Le jour, officiers et soldats vont sous prétexte
de chasse, courir la campagne une lieue à la ronde,
emportant
tout ce qu'ils peuvent trouver, et, l'épée
à
la main, menaçant les paysans. Le soir, c'est en vain que
se bat la retraite. Les dits exempts de la marine circulent par
les rues et maltraitent leurs hôtes et autres habitants,
insultant les filles en méchant dessein. Quantité
d'habitants ont été attaqués ; les
vitres
et fenêtres des maisons ont été
cassées
et des coups de pistolet tirés dans les rues. Le dimanche
5 de ce mois, on a assassiné le sieur Louis Chauvel des
Isles, avocat. Aux plaintes faites à ce sujet par le
Procureur
du roi, le Bailli et le Commis du greffe, le sieur de Villeray
(commandant des troupes) aurait répondu avoir fait son
devoir ; ce qui n'est point, vu qu'il a laissé
évader
l'assassin, le sieur Bareil, enseigne, lequel est resté
toute la nuit en ville et a paru hier à 8 heures du matin,
escorté d'un capitaine d'armes et d'un sergent, pour
intimider
les habitants et empêcher l'arrestement qu'on
prétendait
faire du dit assassinateur. Ce qui fait que les soldats en deviennent
plus insolents, d'autant qu'il n'y a pas plus de 40 ou 50 bourgeois
capables de se défendre de l'effort et violence de 150
soldats actuellement en quartier d'hiver.
En
l'endroit, maître
Antoine Boisangé, maître apothicaire, a
déclaré
(...) (qu') étant près de la maison du sieur de
Toulc'hoat, rue de Notre-Dame, environ les 8 à 9 heures
du soir, (...) (il) vit une personne qui par deux fois le rata
d'un fusil ou d'un pistolet, dont il vit le feu et ouit la batterie.
Guy
le Becq, sieur de Cheff
du Bois, procureur, (...) déclare qu'un quart d'heure
après
l'assassinat du sieur des Isles, il fut surpris de voir 4 ou 5
officiers et soldats se ruer sur les personnes assemblées
pour voir l'état de la victime, de sorte que un chacun
prenant la fuite, il fut obligé de se retirer chez le sieur
de Mesgouez Laoust, poursuivi des dits officiers et soldats, les
uns armés d'épées, les autres de
bâtons.
Trois
des dits soldats de
la marine sont même entrés effrontément
dans
la maison de ville, en l'endroit de la présente tenue,
lesquels avertis par le héraut de se retirer, se seraient
transportés de colère et disant "B.... de chasse
gueux", en se retirant. »
(Bulletin
de
la Société Archéologique du
Finistère,
Tome XLVI)
Les
habitants se plaignent
sans cesse d'être obligés d'héberger de
nombreuses
troupes. Toujours à Lesneven :
« 3
Avril 1708 : Le
substitut du procureur du roi remontre l'accablement où
l'on est par le logement des gens de guerre, actuellement ou
continuellement
depuis 20 ans, sans relâche, et notamment, depuis septembre
dernier, de plus de 250 soldats de marine, avec les officiers,
faisant 4 compagnies, non compris leurs femmes et leurs enfants,
qu'ils installent les trois quarts d'entre eux chez leurs
hôtes,
malgré ces derniers, quoiqu'il n'y ait pas à
Lesneven
80 maisons à pouvoir loger ; desquelles, 50 sont de petites
maisonnettes couvertes de chaume, et occupées par de pauvres
laboureurs et artisans, accablés par ailleurs de
misère,
de taxes, capitations, taxes de maisons et tailles de fouages
; nonobstant tout cet accablement, on a encore envoyé hier
40 soldats avec officiers.
Les
habitants demandent
décharge d'une partie des ces troupes ; que
défense
soit faite aux femmes et aux enfants de venir chez les hôtes,
vu que ces derniers ne sont pas tenus de les recevoir, et ne le
peuvent, n'ayant qu'une petite chaumière, où il
n'est pas possible de loger 2 soldats, 2 femmes avec 5 à
6 enfants, alors surtout que le billet n'est que pour 1 soldat,
outre les crimes que ces soldats font souvent en amenant des filles
qu'ils disent être leurs femmes. »
(Bulletin de
la Société Archéologique du
Finistère,
Tome XLVI)
Les
archives municipales
de Guingamp indiquent :
- le 17 Janvier 1686, décès d'un soldat de la Marine, tué par un camarade ;
- le 30 Décembre 1697, un autre soldat de la Marine est assassiné.
A
Port-Louis (près
de Lorient),
- on mentionne, en 1705, une bagarre entre des soldats de la Marine et de la garnison.